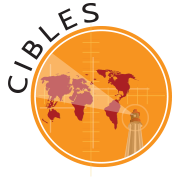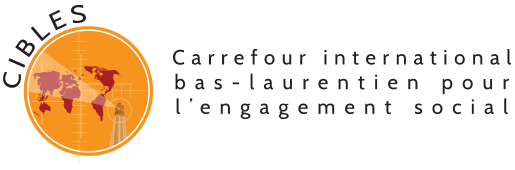Du 4 au 6 juin 2025, une délégation bas-laurentienne composée de membres de l’équipe du CIBLES et de citoyen·ne·s engagé·e·s de Rimouski a participé au Grand rendez-vous des États généraux québécois de la solidarité internationale, à l’Université de Montréal. Ce grand rassemblement, organisé par l’AQOCI, a rassemblé 381 personnes de 15 régions du Québec et de 20 pays. Il visait à faire émerger une vision collective pour renforcer la solidarité internationale face aux grands défis mondiaux.
Une expérience marquante pour nos délégué·e·s :
▶ Marie Bloquel-Perrat, citoyenne engagée à Rimouski, revient avec de nombreuses réflexions : “l’article 15 de la déclaration parle de “bâtir des ponts”. Mais comment rejoindre les personnes à l’extérieur de nos luttes alors que les espaces de dialogue se raréfient? »
▶ Saidou Hassane, également citoyen engagé à Rimouski, retient surtout deux ateliers : les enjeux de la décolonisation de l’aide et de la gestion des crises sécuritaires l’ont marqué. Ils appellent à repenser nos approches, à mieux écouter les réalités des pays du Sud.
▶ Maryam Bernard, étudiante à l’UQAR, vivait sa première immersion dans l’univers de la solidarité internationale. Elle en revient motivée par “le constat qu’il n’y a pas une multitude de luttes qui s’ignorent, mais un seul grand combat qu’on mène à travers des approches complémentaires. »
▶ Shahrazède Hasseine, participante aux ateliers Engage ta voix, souligne la reconnaissance croissante du rôle des diasporas dans les projets de solidarité : elle ressort motivée de voir que les expériences, ancrages et engagements des Québécois.e.s issus de l’immigration sont valorisés et pris en compte dans les démarches des organismes. »
▶ Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice générale du CIBLES, revient confiante que nous travaillons dans la bonne direction au CIBLES et que nous intégrons toujours de mieux en mieux les changements de paradigmes (de croyances) nécessaires pour s’extirper culturellement, socialement, économiquement et politiquement, chaque fois un peu plus de siècles de mentalités coloniales ou de domination.
▶ Catherine Berger, coordonnatrice adjointe au CIBLES, a été marquée par les témoignages entendus, qui nous aident à rester connectées aux réalités des communautés du Sud global et à ne pas perdre de vue l’importance de prêter l’oreille — et de prêter notre voix — aux personnes les plus affectées par les bouleversements climatiques.
La Déclaration adoptée aux États généraux n’est pas qu’un texte : c’est un point de départ. Pour des organismes comme le CIBLES, elle guidera nos actions concrètes en éducation à l’écocitoyenneté mondiale. Ensemble, inspiré·e·s par les luttes et savoirs de nos communautés, nous la ferons vivre pour bâtir un monde plus juste, inclusif et durable.
C’était ma première participation aux États généraux, et j’ai beaucoup apprécié les échanges et les moments de partage, tant dans les ateliers qu’en dehors, avec des personnes venues d’horizons divers. Ce fut une occasion précieuse de renouveler ma compréhension de la solidarité internationale et de mieux percevoir les tendances actuelles et les perspectives d’avenir.
Je repars avec le sentiment d’un engagement collectif de plus en plus fort. Deux ateliers m’ont particulièrement marqué : l’un sur la gestion des crises sécuritaires par les organismes de solidarité, et l’autre sur la décolonisation de l’aide. Ces thématiques, très actuelles et interreliées, nous invitent à réfléchir à nos postures et à adapter nos interventions aux réalités changeantes, surtout dans les pays du Sud.
Les États généraux de la solidarité internationale ont été une belle occasion de découvrir la diversité des organismes engagés sur ces enjeux et de rencontrer celles et ceux qui les font vivre. Les ateliers et les plénières ont nourri de nombreuses réflexions que je ramène avec moi à Rimouski, avec l’envie de les faire avancer ici.
L’article 15 de la Déclaration, par exemple, invite à « bâtir des ponts » entre les différentes communautés de mobilisation (étudiant·e·s, groupes autochtones, entreprises d’économie sociale, acteurs·trices non traditionnels·les, etc.) et entre nos luttes, en mettant de l’avant leur intersectionnalité. En plénière, on a aussi parlé de « briser les silos » et de garder des espaces de discussion ouverts, y compris avec les personnes extérieures à nos luttes. Mais comment faire ? Nos médias sont contrôlés par de grands groupes économiques, et certains gouvernements soupçonnent les algorithmes de favoriser les contenus haineux, plus susceptibles de générer des réactions. Alors, quels sont nos véritables espaces pour rejoindre les autres ? Devons-nous privilégier les médias ou les discussions directes ?
Je n’avais aucune expérience en solidarité internationale. Les États généraux m’ont permis de plonger directement dans le grand bain. J’y suis allée pour élargir mon regard, avec l’espoir de réparer un peu le monde. J’en reviens avec l’envie de participer à la construction d’un monde plus juste, plus équitable… plus solid’TERRE.
J’ai été rassurée de constater qu’il n’existe pas tant de luttes distinctes, mais plutôt un grand combat commun, approché de mille façons différentes. Et ces approches convergent de plus en plus. Travailler à la souveraineté alimentaire et à l’agroécologie, par exemple, c’est aussi défendre les droits humains, l’émancipation des femmes, la justice climatique… Il me tarde de me remettre au travail !
J’ai été impressionnée par la qualité des personnes engagées en solidarité internationale. Les discussions étaient riches, critiques et profondes. Le contexte mondial est difficile, et il reste tant à faire.
J’ai apprécié que la contribution des diasporas soit désormais reconnue, et que des organismes s’appuient sur elles pour mieux soutenir des projets dans les communautés qui en ont le plus besoin. J’ai d’ailleurs la chance de participer aux ateliers Engage ta voix, organisés par le CIBLES, qui nous encouragent à nous mobiliser comme membres de diverses diasporas.
Cette rencontre m’a permis de mesurer le chemin parcouru, depuis 20 ans, en matière de décolonisation et de décloisonnement de la solidarité internationale. Il reste bien sûr beaucoup à faire pour transformer les mentalités et affaiblir les impérialismes, mais les choses bougent.
Au-delà des concepts et critiques des discours dominants, des actions portées par des valeurs féministes, antiracistes, écologistes, d’équité et d’émancipation sont bel et bien en cours. Ce grand rendez-vous nous a permis de nous relier pour mieux avancer ensemble.
Les interconnexions entre les luttes vécues ici et ailleurs sont si fortes que j’ose croire que les rapports de pouvoir inégaux cèdent progressivement la place à des partenariats équitables et réciproques. Malgré la domination du capitalisme, des réinventions sont en marche. Elles grandiront dans un terreau de solidarité, de résistance… et d’amour radical pour l’humanité.
« Lorsqu’on annonce de la chaleur au Québec, tout le monde est content. Chez nous, les températures qui augmentent, c’est la sécheresse dans les champs et des gens qui souffrent – surtout des femmes et des filles. » Cette phrase, lancée sans détour par un représentant sénégalais lors de l’atelier Action climatique féministe, m’a profondément marquée. Elle résume crûment l’impact différencié des crises climatiques.
Ces rencontres nationales, où s’expriment des représentant.e.s du Sud global, nous aident à rester connectées à ces réalités, à écouter et relayer les voix des plus touché.e.s. Pour moi, elles renforcent la nécessité d’ancrer notre éducation à la citoyenneté mondiale dans une perspective solidaire, féministe et décoloniale. L’éducation qu’on pratique ici prend tout son sens quand elle devient levier d’engagement ancré dans les réalités vécues ailleurs.